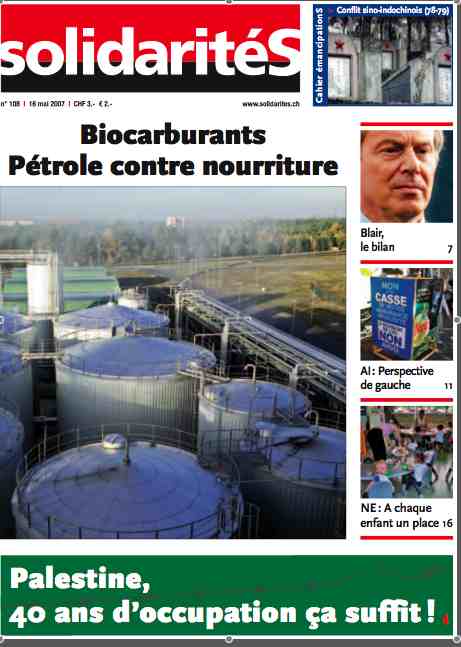Chassez ces gueux, mais maintenez-les en vie!
Chassez ces gueux, mais maintenez-les en vie!
Le 8 juillet prochain, les
Lausannois-es prononceront, par référendum, sur la
pertinence douvrir en ville un «espace de consommation de
stupéfiants», jumelé à un «bistrot
social». La lutte sera âpre et les jeux ne sont pas faits,
tant la juste croisade contre la drogue et lidéologie
sécuritaire ont fait des ravages dans lopinion.
Malgré le caractère forcément limité de ces
mesures, il est important que les citoyen-ne-s les approuvent.
Le vaste projet de refonte du dispositif global en matière de
toxicomanie et de marginalité, approuvé le 15 mai dernier
par le Conseil communal à une majorité des deux tiers,
est lissue dun long processus entamé par les
Autorités en 1996, avec la remise de matériel
dinjection en ville puis, en 1999, louverture de lieux
daccueil à bas seuil pour toxicomanes et marginaux.
Lespace de consommation sera jumelé avec un bistrot
social, géré par une association comme nimporte
quel établissement public. Les deux structures, outre la
réduction des risques dinfection et de contamination par
les virus HIV et de lhépatite C (HIC) et B [HIB), sont
également, sinon principalement, destinées à vider
la place de la Riponne de ses «gueux», aux comportements
inquiétants pour les passant-e-s et surtout défavorable
à la Sainte Eglise de la consommation. Cest
loccasion aussi, pour la Ville, de passer méthodiquement
en revue toutes les structures daide et de soutien aux
marginalisés, nées sans grande coordination au cours des
dix dernières années, au fur et à mesure de
lapparition de populations fortement appauvries: toxicomanes,
mais aussi requérant-e-s dasile, sans-papiers, familles
dites du «quart-monde», jeunes adultes en rupture de
famille, décole et de travail, personnes
âgées, malades psychiatriques en refus de soins, etc.
Chasse gardée et prohibition
Conceptualisée à la fin des années 1980, en lien
avec la pandémie du sida, la réduction des risques
liés à la consom-mation de stupéfiants
sinscrit dans une politique de santé publique
fondée sur lacceptation, bon gré, mal gré,
de cette réalité sociale quest la drogue.
Puisquil est illusoire despérer que les
toxicomanes renoncent spontanément à leur consommation,
puisquon ne peut les y contraindre, ils doivent au moins pouvoir
protéger leur santé, réduisant la menace de
contamination sexuelle quils font peser sur la population. A
partir de 1990, la Suisse a adopté à son tour cette
nouvelle approche, lintégrant dans sa «politique
des quatre piliers»: prévention, thérapie,
réduction des risques et aide à la survie,
répression.
Si le pilier de la réduction des risques accepte, de fait, la
consommation de stupéfiants, il nest en aucune
manière une contestation de la criminalisation de cette
consommation. Il reste basé sur le prohibitionnisme,
linterdiction de tout usage laïc des pharmaka. La
Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de
19611, entrée en vigueur en Suisse en 1970, est claire:
«La Convention unique […] vise à restreindre
lutilisation des stupéfiants aux fins médicales et
scientifiques et à prévenir leur détournement et
leur abus, tout en assurant leur disponibilité pour des fins
légitimes.»
Les consommateurs-trices illicites se déclinent sous trois
figures dans la politique des quatre piliers, toutes marquées
par une «pathologisation biopsychosociale». Le
délinquant, qui trafique pour assurer son approvisionnement, se
verra appliquer la répression. Le malade, couramment
appelé «toxicomane», doit soigner son addiction en
thérapie et atteindre labstinence. Enfin
l«usager», cible de la réduction des risques,
certes également délinquant et malade, est aussi un-e
citoyen-ne, apte à choisir ce qui est mieux pour lui. De ce
point de vue, la réduction des risques a aussi un petit parfum
didéologie libérale… La méthode
intègre bien une dimension collective, mais uniquement dans la
protection de la population des épidémies et des
nuisances sociales. Elle continue à ne prendre en compte les
toxicomanes que comme des individus, finalement responsables de leur
addiction ou alors sommés de se considérer comme des
malades.
Pauvreté et précarité
Cette vision néglige que le développement de la
consommation de stupéfiants au cours de ces dernières
décennies est lié à la montée du
précariat, à la désagrégation des
solidarités populaires.2 Ainsi, les
usagers-ères du futur local dinjection lausannois seront
probablement en grande partie issus des couches les plus
dominées de la population. Des jeunes, et moins jeunes, pauvres,
vivant du Revenu dinsertion, de rentes AI, à
lissue de parcours menant dun apprentissage (pas toujours
terminé) de boulanger, cuistot, vendeur, ouvrier du
bâtiment ou boucher, plus rarement demployé de
bureau, au chômage, au travail temporaire, et finalement à
labandon de la lutte. On y rencontre également une
proportion effrayante de jeunes ayant passé une partie de leur
enfance en foyer, en famille daccueil, enfants de
chômeurs, de parents diagnostiqués
«dépressifs» par la Faculté. La drogue se
consomme dans toutes les classes, mais selon lorigine, les
destins individuels sont différents…
Saluée et soutenue par la plupart des intervenant-e-s sociaux
auprès des marginaux, louverture du local
dinjection, parce quelle est associée à une
redistribution des cartes et des subventions de tout le
dispositif, suscite quelque critiques. Certains pointent le fait que
cette réorganisation est basée uniquement sur «les
trois S»: seringues (Distribus, distributeurs automatiques, local
dinjection), soupe (des repas seront dorénavant servis
deux fois par jour, sept jours sur sept, aux pauvres de tout poil, mais
aussi bistrot social) et savon (le Point deau). Quen
est-il du quatrième pilier, celui de linsertion ou de la
réinsertion, aussi indispensable que les autres, et dont les
subventions sont réduites? Ils-elles constatent,
désabusés que le dispositif remis au goût du jour
par la Ville de Lausanne ne vise quà maintenir les gens
en vie. Mais pour quel avenir?|
Diane Gilliard
1 www.unodc.org/pdf/convention_1961_fr.pdf
2 Voir solidaritéS no 107, linterview de Loïc Wacquant: «Marginalité
et violence dans les villes, quels liens avec la précarité du travail».